Interview de Ombeline Mahuzier, procureure de la République de Châlons-en-Champagne
14 décembre 2020 – Miss Konfidentielle s’attache à mettre en lumière des belles figures de la Justice. Ombeline Mahuzier, procureure de la République de Châlons-en-Champagne et présidente de l’association Femmes de Justice nous offre un moment privilégié.
Bonjour Ombeline,
Vous connaissez le fil rouge des interviews de Miss Konfidentielle. Aussi, vous êtes invitée à nous conter votre parcours tel un récit…
Avec plaisir. Je suis née en Bretagne, dans les côtes d’Armor, à Saint Brieuc, une ville toute proche de la mer, où habitaient mes grands-parents maternels. J’aime beaucoup cette région où je passe encore beaucoup de temps : j’aime les chemins de douaniers escarpés et sauvages, les parties de pêche à pied et les sorties à la voile dans les embruns, la simplicité et le rapport fort à la nature que permettent ces activités. J’aime l’authenticité de ces moments de vacances, en famille ou entre amis, nous passons beaucoup de temps dehors et nous vivons au rythme des marées.
Pour autant, je ne sais pas si je dirais que je suis « originaire » de ce département que j’aime.
J’ai tendance à considérer que les racines doivent nous permettre de nous connaître et pas nous entraver, de créer des liens, pas de nous attacher.
Mes parents ont vécu d’abord en Algérie lorsque j’étais toute petite, puis en côte d’Ivoire, où mes grands-parents paternels ont vécu près de 20 ans. il m’arrive souvent de ressentir une connexion particulière avec des personnes ayant des origines africaines, du Maghreb ou d’Afrique de l’ouest : je partage avec eux des souvenirs, des images, des paysages, des odeurs et des goûts de mon enfance. Mon bestiaire était constitué de singes et de crocodile. Je n’ai pas encore pu y retourner mais je souhaite pouvoir le faire un jour.
Nombreuses sont les personnes déracinées ou exilées, les gens freinés par leurs origines réelles ou supposées ; c’est une chance pour moi que de pouvoir ainsi vivre une complicité simple avec des gens qui ont grandi en France mais sont nés ailleurs, comme avec celles et ceux qui, nés en France, ont aussi une partie de leur cœur de l’autre côté de la Méditerranée ou sous l’équateur.
J’ai souhaité devenir magistrate dès l’adolescence, je crois que précisément d’ailleurs je voulais être procureure. Je ne mesurais pas tout ce que cela représentait à l’époque, mais je voulais d’une part exercer l’action publique, et d’autre part agir contre l’injustice. J’avais été très marquée par les conflits entre le Royaume-Uni et l’IRA, les mesures dérogatoires au droit prises au nom du terrorisme, l’erreur judiciaire terrible de Gerry CONLON et des 4 de Guildford – ils ont été innocentés quand j’avais une dizaine d’années. L’apartheid a été aboli en 1991, c’était les années de la fin du rideau de fer et la chute du mur de Berlin. J’avais entre 10 et 15 ans, je commençais à me forger une conscience citoyenne et à m’interroger sur ce que je pouvais apporter à la société qui m’entourait, alors que ces évènements majeurs se succédaient. La mobilisation politique des citoyens avait des résultats concrets, visibles et des impacts forts sur les institutions, et dont le point commun était la conquête de la liberté et des droits. Mes parents s’intéressaient beaucoup à ces questions sociales et politiques, et nous en parlions souvent. Ils avaient à cœur d’entretenir chez leurs enfants un regard critique sur le monde, et de nous aider à ne pas considérer les stéréotypes ou les idées reçues pour acquises. Ils m’ont aussi aidée à avoir conscience que j’avais des capacités d’action et d’analyse sur le monde qui m’entourait, même très jeune.
J’ai fait des études de droit d’abord à la faculté de Rennes 2 puis à l’université Panthéon Assas à Paris – j’avais passé mon bac en banlieue parisienne et ce départ vers la province me permettait de gagner en autonomie et en liberté. Et puis j’avais repéré qu’on y faisait du droit pénal et de la procédure pénale dès la deuxième année, que j’étais impatiente de découvrir. Je suis donc revenue ensuite à Paris, d’abord à Assas où j’ai poursuivi ma spécialisation en matière pénale et processuelle, puis à la Sorbonne où j’ai suivi un DEA consacré aux droits processuels. Pendant toutes mes études de droit, je me suis passionnée pour la procédure, et avant tout la procédure pénale. La procédure peut sembler être un domaine juridique aride, c’est en réalité le cœur palpitant de la démocratie, bien davantage que le droit pénal de fond à mon avis. On peut tout interdire, créer des infractions qui ne sont jamais appliquées, c’est d’ailleurs parfois le cas, ou au contraire n’avoir en droit positif que quelques textes d’incrimination limités. Mais c’est sur la procédure que reposent les équilibres fondamentaux de la démocratie, c’est la procédure pénale qui limite le pouvoir de contrainte des autorités sur les individus, la limitation de la puissance publique. Chaque règle est un enjeu extrêmement concret pour les libertés. J’ai choisi d’étudier le droit par passion pour la procédure.
Je suis entrée à l’ENM en 2003, heureuse d’avoir accédé à cet objectif que je m’étais fixé. Mais je me souviens avant tout du sentiment d’être à ma place, là où je devais être.
J’ai effectué mon stage juridictionnel de 18 mois au TGI de Nantes, où j’ai fait des rencontres professionnelles très riches, et où j’ai noué des relations qui sont encore vivaces aujourd’hui avec plusieurs magistrats comme Gwenola Joly-Coz qui m’avaient accueillie en stage, Martine Bardet et Frédéric Desaunettes, Jean-Marie HUET aussi qui était alors procureur ; ils m’ont beaucoup appris. Des figures inspirantes et bienveillantes, que je consulte encore lorsque je cherche conseil.
Bien classée au concours de sortie, j’ai choisi mon premier poste au parquet de Versailles. J’ai été quelques mois au service général, puis au parquet des mineurs. J’y suis restée trois ans. J’appréciais particulièrement les relations avec les juges des enfants, relations complémentaires, dans le respect du positionnement de chacun.e mais qui se tissaient autour d’un véritable partenariat pour sortir les enfants et les adolescents de la délinquance, et les inscrire dans un parcours de vie protecteur et constructif, à l’abri d’eux-mêmes et de leurs parents si nécessaire.
J’ai ensuite exercé 5 ans comme juge d’instruction à Créteil. J’y traitais surtout la délinquance structurée autour du grand banditisme et des trafics de stupéfiants. C’était une autre criminalité, un autre public, donc d’autres procédures que celles que j’avais pratiquées au service des mineurs, et pour moi un rôle différent dans les rapports avec les avocats et les services d’enquête. Avec les justiciables aussi : lors d’interrogatoires, de confrontations, d’auditions, les gens passent plusieurs heures dans votre cabinet, séparés de vous par un simple bureau. Il n’y a pas cette distance qu’instaure l’audience ou le défèrement. Vous avez le temps d’instaurer un dialogue, d’explorer la psychologie et les failles des personnes qui sont en face de vous. J’étais également juge assesseure à la cour d’Assises et je présidais des audiences de comparution immédiate. Des audiences intenses, lourdes d’enjeux humains, avec un impératif pour la justice de se faire comprendre. J’avais des relations de grande confiance et de proximité à l’égard de mes greffières, pour lesquelles j’ai beaucoup d’admiration. Notre travail reposait sur une estime et un respect réciproque. Après une première expérience au parquet, ces années au siège représentent une part importante de mon parcours professionnel.
J’ai rejoint la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) en janvier 2014, fière d’entrer dans ce lieu marqué par le temps, et l’histoire des institutions ; les salons de la place Vendôme et les « ors de la République » font rêver la majorité des étudiants en droit, parce que ces lieux nous rappellent que le droit est le produit de l’histoire des hommes.
D’abord au bureau de la politique pénale générale, j’étais notamment chargée du suivi des affaires sensibles en matière de crimes de sang, de disparitions et d’enlèvements, et de la politique pénale relative aux violences conjugales. C’était bien avant le grenelle consacré au violences faites aux femmes, qui n’était pas encore considéré comme une grande cause nationale, et j’ai beaucoup travaillé sur la façon de mobiliser les professionnels et de combattre la banalisation de la violence qui semblait parfois engourdir les consciences.
En octobre 2014, j’ai pris la tête du Pôle d’Evaluation des Politiques Pénales. C’est un bureau transversal, rattaché au cabinet de la directrice (c’était une directrice lorsque j’y ai été nommée et une autre lorsque j’en suis partie presque 5 ans plus tard), et composé de douze personnes : magistrats, greffiers, directeur de services de greffe, attachés d’administration et agents contractuels aux profils variés et peu courants dans les administrations publiques.
C’est un pôle qui analyse les données relatives à l’activité judiciaire, réalise des travaux statistiques et des études d’impact et accompagne l’écriture des textes en matière pénale. Il contribue à la synthèse des informations transmises par les procureurs généraux sur la mise en œuvre des politiques pénales sur le terrain. La définition de nouveaux indicateurs de performance et la lecture des tableaux de données et des graphiques statistiques paraissaient pourtant très éloignés mes fonctions de juge d’instruction… Le pôle assure enfin un suivi des projets de recherche universitaire, ce qui m’a amenée à rencontrer de nombreux chercheurs en sciences sociales, qui m’ont permis de développer une vision transversale et prospective de la matière pénale, au-delà de l’approche par le droit. A ce poste, j’ai participé à des groupes de réflexion sur l’open data avec le conseil d’Etat et la cour de cassation, à des instances de gouvernance des systèmes informatiques et des logiciels métiers, j’ai aussi eu la chance de participer au jury du prix Vendôme pendant 5 ans.
J’avais conservé de mon premier poste le goût du travail en équipe, et de mes fonctions à l’instruction, celui du partenariat avec le greffe et de la direction des enquêteurs ; cette 1ère expérience managériale et dans des fonctions transversales a donc été très riche. J’ai aimé impulser une dynamique collective, établir des objectifs partagés et mobiliser les talents de chacun, en veillant à construire un environnement de travail bienveillant, malgré une activité très intense. C’était très stimulant et j’ai le sentiment d’y avoir beaucoup donné, mais aussi beaucoup appris.
Cela m’a assez naturellement conduite à m’intéresser au pilotage des parquets, et suscité l’envie de prendre la tête d’un parquet. Je souhaitais retrouver l’action publique dans une approche plus opérationnelle, et renouer avec la pratique du droit et de la procédure pénale au contact du terrain et des justiciables.
Vous exercez la fonction de procureure de la République de Châlons-en-Champagne depuis le mois de juin 2019. Quelle est la suite du récit…
La procureure est une actrice majeure de la procédure, garante de l’égalité des citoyens devant la loi, et de la lisibilité de l’action judiciaire pour ses partenaires, qui exerce l’action publique dans l’intérêt général. Mon périmètre excède très largement le pénal : état civil, délégations de l’autorité parentale, tribunal de commerce, le parquet est présent à tous les stades de procédure et devant toutes les juridictions. J’ai à cœur d’aller régulièrement à toutes ces audiences qui concernent l’ordre public économique, familial, l’exécution des peines etc. C’est une fonction passionnante parce que très complète : d’autorité, de direction d’équipe, d’administration, d’analyse juridique, de communication… Face aux justiciables, aux enquêteurs comme aux médias, il faut savoir faire preuve d’une autorité assumée et proportionnée, et délivrer des messages clairs, mais aussi faire preuve d’écoute et d’humanité. Il faut des capacités de décision en temps réel, de gestion de crise et d’engagement.
Il faut aussi veiller aux dispositifs de prévention de la délinquance, de sécurité, d’insertion, d’accompagnement social ou encore d’accès au droit, en construisant des relations avec de nombreux partenaires comme le barreau, les autres administrations, la préfecture, les élus locaux, la PJJ, la DAP les associations locales… Les procureurs sont dans les villes, dans les médias, dans les services d’enquête, en permanence en mouvement, en lien avec de nouveaux interlocuteurs, doivent construire de nouvelles façons d’agir pour atteindre de nouveaux objectifs.
Etre procureure c’est aussi, et c’est là une aventure humaine très stimulante, être cheffe de juridiction, et diriger une équipe. Dans une juridiction à taille humaine comme le Tribunal de Chalon, où le système repose directement sur chaque individu, la présidente et moi-même travaillons main dans la main pour susciter l’adhésion, accompagner les changements, apporter de l’aide et créer avec la direction des services de greffe, une communauté de travail harmonieuse. Nous sommes soudées par des valeurs communes, et travaillons dans la confiance et le dialogue.
Nous sommes six magistrat.e.s au parquet, 16 au siège, et environ 70 greffiers et fonctionnaires. La taille critique de la juridiction nécessite une attention renforcée aux questions d’organisation et de management, une gestion fine des ressources, des forces et des faiblesses de chacun et chacune.
J’essaie ainsi de proposer aux membres de mon parquet, comme à toutes les personnes qui composent la juridiction, une vision inspirante des fonctions judiciaires, et d’offrir un environnement de travail serein, quelle que soit l’intensité de l’activité, afin de de permettre à chacun.e. de s’épanouir à la mesure de ses envies, de ses compétences et de ses talents.
En toute spontanéité, des souvenirs marquants vous viennent-ils en mémoire ?
A Versailles, je me souviens de ce procès d’une nourrice, que j’avais poursuivie pour homicide involontaire, suite au décès d’un tout petit enfant, en raison d’un défaut de surveillance. Toutes les vies étaient brisées ce jour-là et j’ai conservé le souvenir du sentiment à la fois que la justice ne changerait rien à ce qui s’était passé, ni pour les uns ni pour les autres, mais en même temps que c’était pour toutes les parties une étape indispensable pour dépasser ce drame.
Je me souviens du premier mineur âgé de 16 ans pour lequel j’avais requis la détention, sa première incarcération. Incarcéré à la barre, il avait tenté de s’enfuir, sous les yeux de ses parents qui ne parvenaient plus à contenir sa violence. Le terme délinquance des mineurs cache la réalité de familles déchirées et de ces enfants qui sont en grande souffrance.
Le souvenir de ma première visite du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy, du choc que cet univers carcéral avait suscité chez moi, me revient avec force. Très vite, je me suis sentie triste. L’arrivée devant ce grand vaisseau, le tunnel qu’il faut traverser pour parcourir la prison, l’odeur des cuisines et du tabac froid, comme une brume qui s’accrocherait à vos vêtements. Le bruit des verrous qui vous précède et qui vous suit. Ce n’est pas vous qui entrez en prison, c’est la prison qui vous absorbe.
Juge d’instruction, je me souviens notamment de dossiers très complexes de trafics de stupéfiants : les trafiquants avaient organisé un véritable supermarché de la drogue, à quelques minutes de RER de Paris, et nous avons mené avec les policiers un travail de plusieurs mois d’observations, d’écoutes téléphoniques, de terrain, de recueil d’informations, pour parvenir à démanteler ce réseau et interpeller plus d’une vingtaine de personnes. A l’audience, les plus impliqués ont pris jusqu’à dix ans d’emprisonnement ferme.
A la DACG, je me souviens notamment de l’attaque terroriste du Thalys, j’étais de permanence, de ma première « alerte enlèvement », lorsqu’un homme avait enlevé ses deux enfants après avoir tué sa femme. Le dispositif que nous avons mis en place l’a incité à se rendre et nous avons pu récupérer les enfants sains et saufs.
Des échecs probablement ?
Tous les échecs font avancer, je n’en ai pas un en mémoire que ne m’ait appris quelque chose. Je combats âprement ce sentiment d’imposture qui survit souvent chez les femmes que la peur de l’échec peut brider, ou qui craignent d’être moins légitimes parce qu’elles peuvent commettre des erreurs. D’ailleurs tout le monde en fait et la carrière de chacun est nécessairement parsemée d’embuches qui ont pu passer pour des échecs sur le moment et sont devenus des forces. Les hommes ne se posent pas tant de question bien souvent, et ils ont raison sur ce point. La main d’une juge ou d’un procureur ne doit pas trembler lorsque le magistrat prend sa décision, mais nous devons garder à l’esprit à chaque étape qui forge notre décision, que nous pouvons nous tromper.
Sur un tout autre registre, quelle est votre appréciation des rapports que vous entretenez avec la maison police et la gendarmerie nationale ?
Les relations avec la police et la gendarmerie sont une part majeure de notre activité. Par téléphone dans le cadre de la permanence, dans les réunions institutionnelles, sur le terrain, aux audiences….
Elles sont basées sur trois choses : la confiance réciproque, la transparence, et le respect rigoureux des rôles de chacun. On dit souvent que la confiance n’exclut pas le contrôle, j’estime que l’inverse est également vrai.
Le contrôle procédural et le pouvoir de direction que nous exerçons ne nous empêchent pas d’être à l’écoute des contraintes et des inquiétudes de la police et de la gendarmerie, de même que notre proximité professionnelle avec les OPJ ne nous empêchent pas de porter une appréciation rigoureuse sur le respect des procédures. Nous avons une mission à assurer, qui n’est pas la même, et c’est dans la clairvoyance sur le rôle des uns et des autres que nous pouvons travailler sereinement, même lorsque nous ne sommes pas d’accord.
La police et la gendarmerie sont nos interlocutrices privilégiées, le parquet les dirige dans leurs missions de police judiciaire, et veille à la régularité des procédures, à la qualité des preuves recueillies, et à la proportionnalité des moyens employés. Nos relations sont très bonnes au quotidien, nous nous comprenons, nous nous écoutons, et nous nous respectons. C’est le secret d’une collaboration efficace et fructueuse. Nous devons aussi les aiguiller, les challenger parfois sur les résultats attendus, comme ils sont fortement en attente de la réponse pénale.
Deux activités transversales vous tiennent à cœur semble t-il..
Absolument. Adhérente de la première heure, j’ai été élue présidente de l’association Femmes de justice en avril 2018.
Fondée en 2014, c’est une association partie de la force collective des femmes, qui rassemble des magistrates et magistrats, des directrices de services de greffe, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’administration pénitentiaire, pour favoriser l’égalité, la parité, et la mixité au sein du ministère. Je suis très entourée et très soutenue par de nombreux adhérents et adhérentes, comme Valérie Dervieux., Marie Derain de Vaucresson, Christelle Rotach ou encore Sylvie Vella.
Mon engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes fait échos aux valeurs d’équilibre, de bienveillance et de transparence qui irriguent les obligations déontologiques des magistrats.
Je suis aussi mobilisée dans ma vie quotidienne et ma pratique professionnelle tant sur la lutte contre le sexisme ordinaire que sur la politique publique en la matière.
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au ministère de la justice, c’est un fait, et encore souvent un sujet d’inquiétude, davantage d’ailleurs que de préoccupation. La politique publique en faveur de l’égalité est encore très peu développée parce qu’aucune volonté politique n’est venue lui donner le souffle et l’élan dont elle a besoin pour fédérer. Le ministère s’est beaucoup concentré sur la lutte contre les violences faites aux femmes, ce qui est une bonne chose, mais n’a pas encore fait son autocritique et sa révolution en matière d’égalité femmes hommes dans ses propres rangs.
Alors que les femmes sont plus nombreuses, et précisément parce qu’elles sont plus nombreuses, le ministère a très longtemps cru pouvoir faire l’économie d’une politique en faveur de l’égalité et de la parité. Ce faisant, non seulement il a accepté les inégalités et perpétué des méthodes de travail, de management dépassée, mais il a reproduit des mécanismes d’exclusion des femmes, et alimenté un schéma de répartition des rôles et des fonctions selon le genre. La gestion des ressources humaines de la magistrature doit se moderniser. A peine 30 % de procureurs de la république sont des femmes, alors que les femmes représentent 65 % des magistrats !
Ce constat a suscité chez moi un choc salutaire, qui m’a mise en mouvement. J’ai toujours été féministe mais la conscience des retards et des inégalités dans mon propre ministère n’est pas venue immédiatement, comme chez beaucoup d’entre nous. Femmes de justice m’a ouvert des perspectives de réflexion, m’a amenée au-delà de mon quotidien professionnel ; c’est un lieu de rencontre et de solidarité.
Le « networking », à l’heure où tous les outils professionnels sont construits en réseau, est devenu une méthode de partage interactif, dynamique et relationnel. C’est dans cette conception moderne que s’inscrivent les réseaux féminins ministériels, dont femmes de justice fait partie. Les associations d’anciens élèves, de promotion sont d’autres exemples de structures de dialogue et d’entraide qui sont bien ancrés, et qui ont longtemps été essentiellement masculins, comme d’ailleurs les clubs de réflexion ou d’influence, traditionnellement interdits aux femmes. Nous devons investir ces lieux de partage et en créer de nouveaux, où la parole peut circuler et s’enrichir entre hommes et femmes, dans une configuration favorable à la parité et à l’équilibre.
Ma participation à l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) me tient aussi cœur.
J’avais accepté d’intégrer le conseil scientifique dans le prolongement de mon travail sur les méthodes statistiques et sociologiques à la DACG, ayant particulièrement apprécié les activités scientifiques et interdisciplinaire. J’y ai rencontré beaucoup de chercheurs et de professionnels passionnants.
J’ai dû y renoncer très récemment, car mes fonctions de procureure ne me laissaient plus assez de temps pour m’y consacrer, et l’OFDT réalise un travail de qualité, qui mérite qu’on y consacre un temps important, en rapport avec le temps qu’y consacrent les chercheurs. Le regard des économistes, des médecins, des philosophes, des sociologues vient nourrir ma réflexion et mes pratiques professionnelles. Cette interdisciplinarité nous aide à penser notre action et nos messages, à documenter nos constats et à les rendre compréhensibles par tous. Je suis souvent inquiète, quel que soit le métier concerné, lorsque quelqu’un s’appuie uniquement sur sa propre expertise pratique pour tirer des analyses et formuler des avis.
L’année 2020 touche à sa fin, complexe en bien des points. Que pensez-vous de cette réalité ?
Je pense que la crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier que la justice est un service essentiel de l’Etat, et que les libertés, les droits et l’égalité, sont toujours en construction.
Les citoyens s’inquiètent de la restriction de leur liberté, les représentants de l’autorité publique sont mis en cause, et les institutions soumises à rude épreuve.
Ces derniers mois nous montrent que l’Etat de droit ne peut pas être tenu pour acquis ; il faut œuvrer pour le faire vivre chaque jour dans nos fonctions comme dans nos consciences.
A l’heure où l’urgence de la gestion de crise nous prive parfois de recul, la peur ne doit pas faire oublier le droit, et la justice dans son indépendance est notre rempart contre toute dérive.
Quelle serait alors votre philosophie de vie ?
Je suis d’une grande curiosité, et je pratique beaucoup d’activités variées. Je conçois mes loisirs comme des occasions de rencontres, de me ressourcer en ouvrant de nouveaux horizons, cela peut être en faisant de la plongée sous-marine comme lors d’une visite de musée (sourire). J’aime énormément voyager, je lis beaucoup, je marche aussi, et je pratique la méditation.
D’une manière générale, je dirais : Avoir du courage. Celui d’avancer, de se dévoiler, de dire ce qui peut déplaire, de reconnaitre qu’on s’est trompée… préserver la liberté et la créativité de chacun.e, partager ses doutes comme ses acquis et mobiliser l’intelligence collective pour progresser. Penser et agir de façon inclusive, en faveur de l’intérêt général.
Un grand remerciement Ombeline pour cet entretien qui nous a menées plus loin que ce que nous avions envisagé. Le récit a pris place à l’interview classique. Un exercice de style bien agréable à travailler.
Notes importantes :
Il est obligatoire d’obtenir l’autorisation écrite de Valérie Desforges, auteur de l’interview, avant de reproduire tout ou partie de son contenu sur un autre media.
Il est obligatoire de respecter les légendes et copyrights des photos publiées dans l’interview :
En Une : Rencontre à la cour de Cassation © Cour de cassation
2de photo : Juillet 2019, jour de l’installation de Ombeline Mahuzier comme procureure à l’audience solennelle de Châlons – Avec dans l’ordre d’apparition, Jennyfer Picoury, présidente du TJ, Carole Van Goetsenhoven, vice-présidente coordonnatrice du service aux affaires familiales, Hubert Barré installé le même jour que Ombeline Mahuzier dans son premier poste, comme juge des enfants et Ombeline Mahuzier © Ombeline Mahuzier
3ème photo : Mars 2020, AG de Femmes de justice – Avec dans l’ordre d’apparition, Gwenola Joly-Coz, Chantal Arens, première présidente de la cour de cassation, Ombeline Mahuzier, Isabelle Raynaud-Gentil, et Nicole Belloubet, alors Garde des Sceaux © Femmes de justice
4ème photo : Mars 2020, AG de Femmes de justice – Avec dans l’ordre d’apparition, Ombeline Mahuzier, Isabelle Raynaud-Gentil, secrétaire générale de Femmes de justice et avocate générale à Aix, Olivier Leurant, alors directeur de l’ENM et Laëtitia Dhervilly, alors sous directrice à l’ENM © Femmes de justice
5ème photo : Rencontre avec la Cour de cassation © Cour de cassation

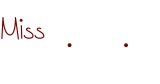





Ce récit est intéressant, pourrais-je le partager sur linkedin ou Facebook?
Merci à vous de prendre le soin de poser la question. Vous pouvez poster le récit sur LinkedIn et Facebook.
En lisant le recit de madame la Procureure, on ne saura pas que c” est Elle qui m”a enferme parce que j” ai accuse Mon ex conjoint de m”a oit viole.
Je suis harcelee par la gendarmerie depuis presque 10ans c” est encore.
Pourtant Madame la Procureure continue le movement.
En 2017 la gendarmerie m’a interdit f’ouvrir un compte en banquet sans l”authorisationn de Mon conjoint, car j”etais soupconnee d”etre avec Lui pour l”argent.
IL n’y a pas de racisme !
Puis, j”ai refuse d”ouvrir un compte bancaire. Et j’ai ete revouee par deux banquet.
Tout ce I controlee par madame la Procureure.
Toujours parce que je suis divorcer et j’ai accuse monsieur Fe m”avoir viole.
Monsieur m”etranglait.
Madame la Procureure qualified cela de ppsydophrenie.
Tout ce I a commence quand en 2008 j”ai dit a la police qu”hi m eleven m”a traite de negresse qui tamenr sa guele.
2ans plus tard, on a demandé a la sage femme lord de Mon accouchement f”abimer Mon vagin.
C’etait telleme t douloureux.
En 2014, cela s”est a grande evhelle, persecuter a l”university.
On m”a contraint a partir.
Je ne peux pas travaille, je ne peux pas etudier me
Humiliation dans Mon Entourage. Persecution a l”eglise.
En 2025 ils ont declare , SI j”etais partie a l”etranger c”est pour faire rentrer ma mere auxx USA. Alors que je parties parce que mon mari me frappait.
Qui Les a raconte que je suis partir pour faire rentrer ma mere en USA ?
Mon pere est venu en France, Bien gentil, IL Se met a bricoler, reparer led machines.
Mon mari qui n “a jamais supporté que qulqu’un m”appreciait, Se met a cree les disputes en présence de mes parents.
Par exemple, il me demandait de choisir son repas a mc Donald’s. Parceque peut être, je ne mangeais comme c”est cher selon lui, afin de lui permettre a lui de manger n”importe quel menu.
On emmène mes parents a Mc Donald’s, je prenais son sandwich comme a la coutumee.
Il répond avec agressivité, tu ne vas quand-même pas choisir mon repas.
Je me sens embarrasser en publique. Je ne comprends pas la réaction, de plus je n”aime pas choisir pour les autres, IL m”avait forcé avant que j”russe accepté et puis cela faisait des années que c”est comme cela. Pourquoi devant mes parents aujourd’hui ?
En Voici un exemple qu”il provoque les disputes.
Mon père très manipulable. Se met a me dire qu”il faut que je sois soumise pour que le mariage dure.
Mon mari met la pression, mon père qui n”arrête pas de faire la morale.
Je dis à mon père je vais appeler la police pour toi.
J”appelle les Pompiers. Puis j”ai raccroché. Les pompiers me rappelle, je leur ai dit : non ce n”est rien . Il n’y a rien.
On était en décembre ou janvier.
Mes parents rentrent chez eux. L”année d’après le procureur ou les gendarmes ont demandé de faire revenir mes parents. Ils reviennent l”année d”apres. Ils ont resté 3mois, peut-être leur maison sur écoute. J”en sais rien. Car on ne traite pas les étrangers comme des personnes ayant des droits en France.
Plus tard, la gendarmerie veut que mon conjoint sache lui raconte plein chose négative sur ma famille.
Sois là gendarmerie avait besoin de rentrer chez moi, soit ils avaient besoin de mon Empreinte.
Ils ont fait dire au mari de créer les conflits. Ce qu”il faisait d”ailleurs depuis 16 ans.
Il rentre un après midi d’octobre. Cela cela faisait 9 mois minimum que mes parents étaient retourné Chez eux.
Il me raconte que j”étais une femme qui est sale. Et je suis mise à me justifier comme d’habitude car c’est quelque chose qui me touche particulièrement depuis qu”il m”a dit que j”étais sale.
Il a appelé les pompiers, comme j”avais fait pour mon père.
Les gendarmes sont venus.
Plus tard ils nous ont convoqué dans leur bureau.
Ils m”ont mes empreintes et mon ADN.
La gendarme me dit que j”ai donné une gifle a monsieur.
Je lui ai dit , je n’ ai pas donné de gifle a monsieur.
Mais monsieur m’étrangler souvent s la maison sans aucune raison.
J”étais complètement perdue, moi qui prend des coups de poings dans le sein, des gifles parfois souvent l’étranglement. Je m’étais retrouvé plusieurs fois a l’hôpital.
Et me voilà être accusé d”avoir donné une gifle.
On est en 2016.
Puis cela va continuer. En 2017, après m’avoir giflé et violée.
J”ai appelé les voisins qui étaient utilisés par la gendarmerie pour m”insulter que mon père était un vas social , qu’on était engrossi par mon père . . .etc
J’ai appelé ces voisins, puis un pasteur voisin de mon père que mon ex conjoint voulait a tout prix qui soit la aussi.
Je leur ai dit qu’il m”a donné des gifles juste avant l”arrivé des voisins, et qu”il est allé plus loin encore.
Et je leur ai dit , vous voyez, je n” si plus de télé a la cuisine.
Parce qu’il m’a frappé, j”ai cassé la télé.
La voisine a répondu : mais tu penses aux enfants ?
Le pasteur a dit est ce que tu l’as insulté ? Par e que un homme frappé lorsqu’il est insulté.
Donc, après cette réunion j”ai déménagé a Bordeaux.
Les gendarmes, m”ont persécuté, mobilisé la maîtresse de l”école pour s”en prendre après moi. Fait taper mon fils dans les cours de récréation et me dire si il y a une marque sur le visage cela veut dire qu”on a reçu une gifle
Ils interviennent dans les agences d’intérim afin qu’on me donne pas de travail. Ils contribuent les entretiens f”emploi en me demandant de parler de mes parents et .
Fonc je reviens au mois de juin. Avant de revenir à la mao , je suis allée voir un pasteur pour lui demander de l”appeler si on avait des problèmes dans le couple , car monsieur ne me frapperait pas si il sait que quelqu’un regardait.
Les gendarmes ont demandé au Pasteur de l”eglise de Reims de me dire. Qu”on ne voit pas la perversion de monsieur, ce sont mes voyages qu”on voit. Que ma mère était une sorcière et que ma culture faisait du tort a monsieur qui doit tout supporter.
Quel j’humiliais monsieur.
Alors, je suis revenue en juin en m’humiliant car partout où je vais , on me donne tort.
Juin, juillet, août, septembre je octobre.
Les gendarmes qui poursuivent leur persecusdion, m’a ont embauché dans un faux e.oi au crédit agricole la banque , après la période f”essaie ils me révoqué t en disant comme d’habitude au”il me manque une roue, que j”ai un P crochu et qu”il n’y avait rien a faire.
Decouragée et honteuse, je pars en Israël 3 jours seulement parce que je pars dans mes enfants.
Je ne les emmène pas car je n”ai pas d”argent pour les accueillir confortablement.
Arrivée en Israël, les gendarmes étaient présents. Ils tournent le voyage de ma sœur en ridicule.
L’organisateur du voyage devait être brute. Ils ont fait spectacle de rues avec moi. Et
En rentrant a l’aéroport, ils disaient a mon conjoint qu”il paye trop cher , pour une femme comme moi.
Qui n”est pas top modèle, ou imitation top modèle.
C’était samedi.
Mon mari qui criait pour un rien, refuse que j”ouvre la bouche.
Alors, je lui demande au soir de me laisser voir les comptes en banque.
Il m”a dit que j’étais une salope qui était allée me faire baiser en terre sainte et que j”étais pire que la teigne, et qu’il ne voulait rien me laisser.
Il m’a attrapé par le coup et frappé contre un placard.
Et il m’a maintenu le cou enfoncé entre ses deux mains il ne m’a pas lâché.
J’avais le bras enflé. Je ne comprenais pourquoi, je dois recevoir des coups rien parce que je veux voir mes comptes bancaires.
J’ai courri a la sallyfe bain, j’ai pris une manche a balai..je lui ai dit je vais te taper avec ce manche a bai. Mais je ne vais pas le faire car tu diras c’est parceque je t’ai frappé qui fait que tu m’as cogné le bras.
Je monte a l’étage. Il m’a suivi. J’ouvre la porte de mon fils qui avait 17zns qui était la ce soir la.
Je l’ai réveillé, et je lui ai dit ton père m’a cassé le bras. Je vais lui donner un coup de manche a balai.
Il a dit non maman, ce n’est pas parce qu’il t’a donné un coup qu’il faut que tu lui donne aussi.
Je lève m’a main pour lui donner le coup de balai. J’ai descendu m’a main. Et j’ai dit à mon fils, qui va faire quelque chose pour moi. ?
Je lève m’a main je lui ai donné un coup de balai au bras gauche, il n”a pas bougé. Je lui ai dit je vais te donner un autre encore. Il n ‘a même pas bougé.
Puis je suis descendie mettre la glace sur mon bras et dormir.
2jours plus tard, je suis allee a l’hôpital.
Il y avait un policier qui leur a dit de ne pas s”o viper de moi.
Une fois a bordeaux, je m’étais coupée, je suis allée pour me recoudre.
On ne m”a pas pris en charge.
Ce 30 octobre l’infirmier m’a proposé une radiographie et c’est tout. Alors je suis rentrée. J”avais peut de voir le bras reste enflé mais comme l’infirmier m’avait rien a faire. Alors je me disais que”il n”avait rien.
Mais jӎtais en pleure, je ne comprenais pas pourquoi il me traitait comme cela.
En revenant de l’hôpital, il est allé à la gendarmerie et disant c”est parce que je n”ai rien a montrer qui fait que je ne suis pas allée à la gendarmerie.
Le gendarme en accord avec son supérieur a falsifié m’a deposition, a monté un dossier de trouble mental.
On est venu chercher mes enfants le 20novembre 2019.
Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai aucun droit de les voir.
Monsieur les autorise a me voir, et son avocat dit qu’il est un saint.
De plus, je suis harcelée, Madame la Procureure m”a fait enfermé en psychiatrie pour 3mois.
20000 euro a disparu sur mon compte, on a trouvé que monsieur m’a trop donné, sous les yeux de la justice, il m”a dépouillé.
On a dit que j”étais revenue de Bordeaux pour lui prendre la maison de son père.
Je lui avais demandé par e qu’il m”avait pris l’équivalent de l”argent de la maison en compte en banque. C”était un juste équilibre.
Donc aujourd’hui Madame la Procureure déclare que je suis colérique. Malgré les gendarmes m’ont harcelée depuis 10 ans cela continue encore.
J’ai été sur écoute depuis 5ans, les gendarmes ont mis une puce sur mon ordinateur qui est même contrôlé a distance car Madame la Procureure veut que mon père soit celui qui m’a a maltraité dans mon enfance.
Ce qui me ramène a douter du récit de madame Mahuzier sur son enfance, comment on peut avoir vécu de beaux souvenirs d’enfance et enfermé une femme pour la forcer a reconnaître de la maltraitance lorsqu’elle affirme qu’elle a eu une enfance dorée. Même si on ne voulait pas sur l’or.
Le psychiatre devait lier m’a pauvreté avec la maltraitance dans mon Mariage.
Si je reconnais pas être pauvre. Alorson mari ne m’a pas frappé.
Oh les gendarmes avaient les photos de mon bras enflé sur mon iPod. Ils l’ont effacé car ils d”en foutent.
J’ai caché pour mon père, eux ils vont cacher pour le français.
Mais ils ne sont pas racistes, hein !
L”a ocate de monsieur s dit a l”audience au”ils ont réussi à prendre les enfants par e qu’il y a eu des enfants traumatisé placé en institution.
Depuis janvier, j”essaie de découvrir de quoi il s”agit.
Maintenant je comprends. En 1998 , 3 mois ou plus après le mariage. Monsieur m’a fait mis en psychiatrie même si c’était 48h.
20zns plus tard, le juge a pris mes enfants sans aucune possibilité de les revoir pour cela.
Voici, ce qui s’était passé. J’avais 20zns, je venais de me marier je ne savais pas que la France était comme cela. Les parents de monsieur débarquait dans ma chambre, a tout heure, ils choisissent même l’endroit que le lit doit se positionner. . .quand je dis à monsieur j’ ai besoin us d’intimité, il refuse, il m’a a même frappé. Alors, je suis rentrée dans un silence, je ne parlais plus. Il m’a emmené chez ce Dr Leclerc qui m”a posé des questions, je n”ai pas répondu. Il a dit : emmène la a Châlons, car les gens de ces pays la sont comme cela.
Et il m”a emmené a Châlons, hôpital psychiatrique. Je suis restée 48h et on m’a laissé sortir.
Étant donné, on voulait a tout prix que je paye donc, le juge a dit que j’ai été maltraité dans mon enfance.
Pourtant pour rester sans amour dans un mariage pendant 23 ans, vous imaginez la patience qu’il faut.
Le juge a fait une expertise spéciale pour monsieur. On dit qu’il était très sympathique.
La psychologue a dit , moi je disais qu’il fallait qu’on fasse très attention à monsieur. Toutefois, il a la garde exclusive, et il n’a même pas a partagé une journée avec moi.
Quand on avait des problèmes monsieur me dit la porte elle est grande ouverte , tu peux partir quand tu veux.
Si je suis restée que par ma seule volonté.
Voilà comment la Procureure a réglé cela. Encore aujourd’hui , elle me fait insulter.
Ou cogner. Par exemple dans l”avion un homme devait me frapper, ce n”est pas la plaisanterie. Le monsieur m”a donné un coup de pied a la tête , ma tête a resonne, d’une extrême violence.
Une fois a bordeaux, le pilier m”a frappé mon doigt était enflé.
Et si je réponds, Madame la Procureure fit: voile c’est toi qui cherchais querelle à la maison.
Il y avait aussi, les propos racistes. On me disait qu’on va me montrer la place d’une negresse car en France chacun devait connaître sa place.
On m’a dit que j’étais un déchet que personne voulait et que mon mari a pris, baissé la tête devant lui car il m’a ramené en France.
J’ai répondu sur ma page Facebook en privé. Que les blanches ne sont pas supérieures aux femmes noires.
Mon avocate m’a répondu dans son bureau fâchée que les blanches étaient supérieures.
Et vous comprenez pendant les 10 mois que mes enfants étaient placés, elle ne m’a rien dit.
Et je ‘e savais même pas ce qui était dans le dossier. Car elles disaient avec l’avocat de monsieur que monsieur était sympathique.
Le juge a dit que j’ai souffrance narcissique identitaire.
Ai si les femmes des services sociaux me disaient maintenant je vais pouvoir mettre des élastiques dans les cheveux de ma fille.
Je la coiffais lors des visites afin qu’elle ne perdent pas ses cheveux, elles disent que je m’intéresse aux cheveux.
Après on m’a empêché de l’avoir pendant 12mois.
J’ai été obligée de couper des cheveux
Elle a même pleuré car elle voulait pas.
Maintenant, je dois accepter qu’ ils m”aiment m’a fille plus que moi.
Et mon fils rentre en 4eme , il était parti, il avait 9 ans.
Ils auraient pu me le rendre quand il rentre en 6 ème ou même 5rme.
Alors , j’ai du mal à croire que Madame la Procureure ne regarde pas a la couleur et a la race pour émettre des jugements.
Le juge même a dit qu’il a pris les enfants par e il y a 20ans je ne pouvais m’adapter yla culture française.
La psychologue du juge a dit que je n’étais pas de mon milieu et que j’étais sans famille ici, et sur je n’avais yma mere avec moi. Tandis que monsieur était chez lui, c’est donc moi qui a un problème.
On donne les enfants a monsieur, moi je peux rentrer chez moi.
Ces propos sont racistes ils devaient être condamnable. Même un juge ne devait pas avoir le droit d’insulter les gens par des propos racistes.rmeme si il est juge.
La France ne m”a pas autorisé à avoir ma famille avec moi. Me prendre mes enfants par e que je suis sans famille.
C’est honteux et minable.